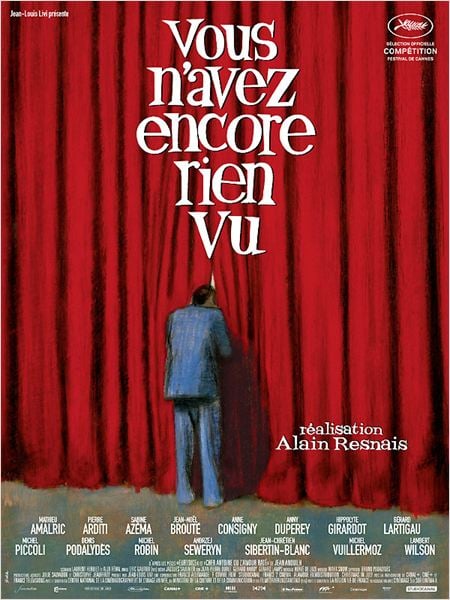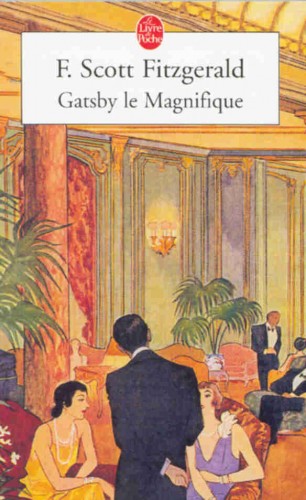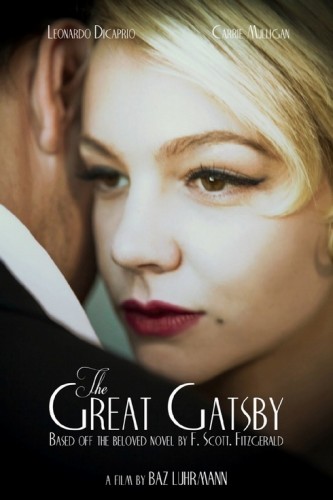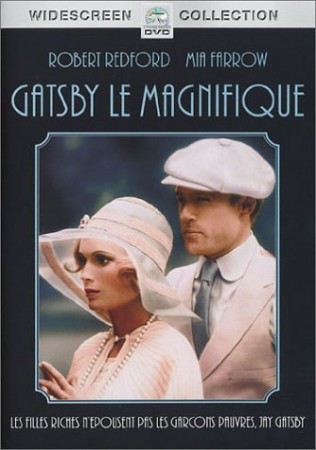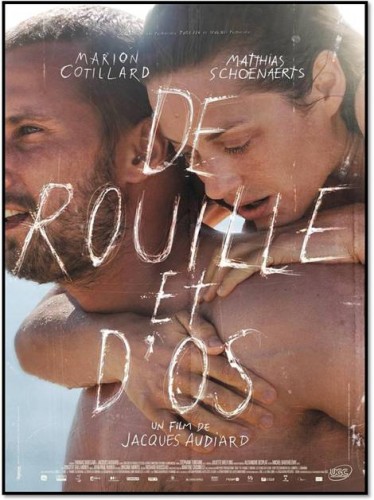Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...
"La Tête haute" d’Emmanuelle Bercot, Film d'Ouverture du Festival de Cannes 2015

Cette année, pour la deuxième fois de l'histoire du Festival de Cannes, c'est une réalisatrice qui fera l’Ouverture du Festival. C’est en effet le film de la française Emmanuelle Bercot, "La Tête haute", qui ouvrira, mercredi 13 mai prochain, la 68ème édition du Festival de Cannes après le Biopic d'Olivier Dahan sur Grace Kelly, l'an passé.
Cliquez ici pour lire mon récit de l'ouverture du 67ème Festival de Cannes.
Un film d'ouverture dont l'annonce me réjouit (Emmanuelle Bercot a notamment coécrit l'excellent scénario de "Polisse", réalisé le troublant "Clément" et "Elle s'en va" qui fut pour moi le meilleur film de l'année 2013 dont je vous propose ma critique ci-dessous) et dont vous pourrez retrouver ma critique ici la 13 Mai.
"La Tête haute" raconte le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu'une juge des enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver.
Tourné dans le Nord-Pas de Calais, en Rhône-Alpes et en Ile de France, il compte dans sa distribution Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Sara Forestier et Rod Paradot qui interprète le personnage principal.
« Le choix de ce film pourra paraître surprenant au regard des codes généralement appliqués à l’Ouverture du Festival de Cannes, - déclare Thierry Frémaux, Délégué général de la manifestation. - C’est évidemment le reflet de notre volonté de voir le Festival commencer avec une œuvre différente, forte et émouvante. Le film d’Emmanuelle Bercot dit des choses importantes sur la société d’aujourd’hui, dans la tradition d’un cinéma moderne, pleinement engagé sur les questions sociales et dont le caractère universel en fait une œuvre idéale pour le public mondial qui sera au rendez-vous à Cannes. »
La Tête haute sera projeté en avant-première mondiale dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals et sortira dans les salles françaises le même jour, mercredi 13 mai prochain. Le film a déjà été vendu dans de nombreux pays.
Comme chaque année, les salles qui sortiront le film pourront également diffuser la Cérémonie d’ouverture.
La carrière d'Emmanuelle Bercot est indissociable du Festival de Cannes. Son talent est découvert au Festival de Cannes en 1997, où son court métrage Les Vacances reçoit le Prix du Jury. Elle confirme l’essai deux ans plus tard avec un Deuxième Prix de la Cinéfondation pour La Puce, son film de fin d’étude. En 2001, son premier long métrage, Clément, dans lequel elle tient le rôle principal, est en Sélection officielle au Certain Regard. Depuis, elle a réalisé plusieurs films dont, en 2014, Elle s’en va, dans lequel on retrouve Catherine Deneuve dans l’un de ses plus beaux rôles.
Emmanuelle Bercot a également co-signé le scénario de Polisse de Maïwenn qui lui a offert le premier rôle de son nouveau film, Mon Roi.
La Tête haute a été écrit par Emmanuelle Bercot et Marcia Romano, et Guillaume Schiffman en est le directeur de la photographie. Il est produit par Les Films du Kiosque, en coproduction avec France 2 Cinéma, Wild Bunch, Rhône-Alpes Cinéma et Pictanovo, et avec le soutien de la Région Nord-Pas de Calais. Il est vendu par Elle Driver et distribué en France par Wild Bunch.
CRITIQUE – ELLE S’EN VA d’Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve

Un film avec Catherine Deneuve est en soi déjà toujours une belle promesse, une promesse d’autant plus alléchante quand le film est réalisé par Emmanuelle Bercot dont j’avais découvert le cinéma avec « Clément », présenté à Cannes en 2001, dans le cadre de la Section Un Certain Regard, alors récompensé du Prix de la jeunesse dont je faisais justement partie cette année-là, l’histoire poignante et délicate (et délicatement traitée) de l’amour d’un adolescent pour une femme d’âge plus mûr (d’ailleurs interprétée avec beaucoup de justesse par Emmanuelle Bercot). Une histoire intense dont chaque plan témoignait, transpirait de la ferveur amoureuse qui unissait les deux protagonistes. Puis, il y a eu « Backstage », et l’excellent scénario de « Polisse » dont elle était coscénariste.
L’idée du road movie avec Catherine Deneuve m’a tout d’abord fait penser au magistral « Je veux voir » de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige dans lequel le dernier regard de Catherine Deneuve à la fois décontenancé et ébloui puis passionné, troublé, troublant est un des plus beaux plans qu’il me soit arrivé de voir au cinéma contenant une multitude de possibles et toute la richesse de jeu de l’actrice. « Elle s’en va » est un road movie centré certes aussi sur Catherine Deneuve mais très différent et né du désir « viscéral » de la filmer (elle n’est sans doute pas la seule mais nous comprenons rapidement pourquoi l’actrice a accepté ici) comme l’a précisé la réalisatrice avant la projection.
L’actrice incarne ici Bettie (et non Betty comme celle de Chabrol), restauratrice à Concarneau, veuve (je vous laisse découvrir comment…), vivant avec sa mère (Claude Gensac !) qui la traite encore comme une adolescente. L’amant de Bettie vient de quitter sa femme… pour une autre qu’elle. Sa mère envahissante, son chagrin d’amour, son restaurant au bord de la faillite vont la faire quitter son restaurant, en plein service du midi, pour aller « faire un tour » en voiture, puis pour acheter des cigarettes. Le tour du pâté de maisons se transforme bientôt en échappée belle. Elle va alors partir sur les routes de France, et rencontrer toute une galerie de personnages dans une France qui pourrait être celle des « sous-préfectures » du « Journal de France » de Depardon. Et surtout, son voyage va la mener sur une voie inattendue…et nous aussi tant ce film est une surprise constante.
Après un premier plan sur Catherine Deneuve, au bord de la mer, éblouissante dans la lumière du soleil, et dont on se demande si elle va se « jeter à l’eau » (oui, d’ailleurs, d’une certaine manière), se succèdent des plans montrant des commerces fermées et des rues vides d’une ville de province, un chien à la fenêtre, une poésie décalée du quotidien aux accents de Depardon. Puis Bettie apparaît dans son restaurant. Elle s’affaire, tourbillonne, la caméra ne la lâche pas…comme sa mère, sans cesse après elle. Bettie va ensuite quitter le restaurant pour ne plus y revenir. Sa mère va la lâcher, la caméra aussi, de temps en temps : Emmanuelle Bercot la filme sous tous les angles et dans tous les sens ( sa nuque, sa chevelure lumineuse, même ses pieds, en plongée, en contre-plongée, de dos, de face, et même à l’envers) mais alterne aussi avec des plans plus larges qui la placent dans des situations inattendues dans de « drôle[s] d’endroit[s] pour une rencontre », y compris une aire d’autoroute comme dans le film éponyme.
Si l’admiration de la réalisatrice pour l’actrice transpire dans chaque plan, en revanche « Elle s’en va » n’est pas un film nostalgique sur le « mythe » Deneuve mais au contraire ancré dans son âge, le présent, sa féminité, la réalité. Emmanuelle Bercot n’a pas signé un hommage empesé mais au contraire un hymne à l’actrice et à la vie. Avec son jogging rouge dans « Potiche », elle avait prouvé (à ceux qui en doutaient encore) qu’elle pouvait tout oser, et surtout jouer avec son image d’icône. « Elle s’en va » comme aurait pu le faire craindre son titre (le titre anglais est « On my way ») ne signifie ainsi ni une révérence de l’actrice au cinéma (au contraire, ce film montre qu’elle a encore plein de choses à jouer et qu’elle peut encore nous surprendre) ni un film révérencieux, mais au contraire le film d’une femme libre sur une autre femme libre. Porter une perruque improbable, se montrer dure puis attendrissante et s’entendre dire qu’elle a dû être belle quand elle était jeune » (dans une scène qui aurait pu être glauque et triste mais que la subtilité de l’écriture et de l’interprétation rendent attendrissante )…mais plus tard qu’elle sera « toujours belle même dans la tombe. » : elle semble prendre un malin plaisir à jouer avec son image.
Elle incarne ici un personnage qui est une fille avant d’être une mère et une grand-mère, et surtout une femme libre, une éternelle amoureuse. Au cours de son périple, elle va notamment rencontrer un vieil agriculteur (scène absolument irrésistible tout comme sa rencontre d’une nuit, belle découverte que Paul Hamy qui incarne l’heureux élu). Sa confrontation avec cette galerie de personnages incarnés par des non professionnels pourrait à chaque fois donner lieu à un court-métrage tant ce sont de savoureux moments de cinéma, mais une histoire et un portrait se construisent bel et bien au fil de la route. Le film va ensuite prendre une autre tournure lorsque son petit-fils l’accompagnera dans son périple. En découvrant la vie des autres, et en croyant fuir la sienne, elle va au contraire lui trouver un nouveau chemin, un nouveau sens, être libérée du poids du passé.
Si le film est essentiellement interprété par des non professionnels (qui apportent là aussi un naturel et un décalage judicieux), nous croisons aussi Mylène Demongeot (trop rare), le peintre Gérard Garouste et la chanteuse Camille (d’ailleurs l’interprète d’une chanson qui s’intitule « Elle s’en va » mais qui n’est pas présente dans le film) dans le rôle de la fille cyclothymique de Bettie et enfin Nemo Schiffman, irréprochable dans le rôle du petit-fils. Ajoutez à cela une remarquable BO et vous obtiendrez un des meilleurs films de l’année 2013.
Présenté en compétition officielle de la Berlinale 2013 et en compétition du Champs-Elysées Film Festival 20013, « Elle s’en va » a permis à Catherine Deneuve de recevoir le prix coup de cœur du Festival de Cabourg 2013.
« Elle s’en va » est d’abord un magnifique portrait de femme sublimant l’actrice qui l’incarne en la montrant paradoxalement plus naturelle que jamais, sans artifices, énergique et lumineuse, terriblement vivante surtout. C’est aussi une bouffée d’air frais et d’optimisme qui montre que soixante ans ou plus peut être l’âge de tous les possibles, celui d’un nouveau départ. En plus d’être tendre (parfois caustique mais jamais cynique ou cruel grâce à la subtilité de l’écriture d’Emmanuelle Bercot et le jeu nuancé de Catherine Deneuve), drôle et émouvant, « Elle s’en va » montre que , à tout âge, tout peut se (re)construire, y compris une famille et un nouvel amour. « Elle s’en va » est de ces films dont vous ressortez émus et le sourire aux lèvres avec l’envie d’embrasser la vie . Un bonheur ! Et un bonheur rare. Le film sort en salles le 18 septembre. Ne le manquez pas.